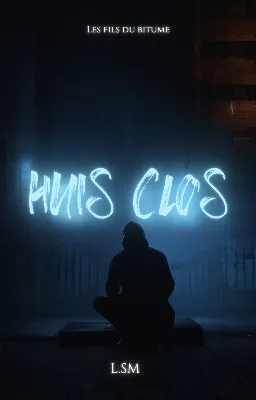Sous les murs, une lumière
Le réveil me tire de mes rêves d’un coup sec. 8h30, l’écran fissuré de mon téléphone clignote. Je laisse l’alarme sonner encore quelques secondes, histoire de bien me rappeler que la journée commence mal. Toujours mal.
Je m’étire, une douleur sourde dans les épaules. J’ai dormi plié en deux sur le canapé-lit, comme toujours. Le salon est dans son état habituel : un bordel organisé. La table basse, couverte de tabac, de beuh et de papiers froissés. Sur le coin, mon carnet, usé, la couverture tâchée, où s’entassent des bouts de textes. Je le fixe une seconde. Je pourrais y ajouter quelque chose. Mais pas ce matin.
La lumière du jour passe à travers les stores vénitien en bois, et le bruit du quartier me parvient déjà. Des voix d’enfants qui crient en bas, un mec qui klaxonne un peu trop fort, et un scooter qui démarre comme une fusée. La cité est réveillée.
Je traîne des pieds jusqu’à la salle de bain. Le carrelage froid sous mes chaussettes blanches me donne un frisson. J’ouvre le robinet, l’eau met trois ans à chauffer, mais j’ai plus l’énergie de râler pour ça. J’attrape mon téléphone pendant que je me passe de l’eau sur le visage. Une notif d’Adria.
Adria: J’ai fini tard hier. On se voit ce soir ?
Je souris malgré moi. Elle essaie. Elle tient bon. J’ai l’impression de la décevoir à chaque fois que je la vois, mais elle reste là. Elle mérite mieux. Ça, je le sais. Mais je sais pas comment faire autrement.
Je lui réponds rapidement :
Ouais, tkt. J’te dis vers quelle heure.
Elle répond presque tout de suite : “Ok.”
C’est tout. Simple et net. Adria, elle est comme ça. Elle parle peu, mais elle dit tout avec rien.
***
Je sors de l’immeuble, capuche relevée, écouteurs enfoncés. L’odeur de shit et de pisse me prend à la gorge dès que je pousse la porte du hall. Y’a déjà deux gars postés en bas, adossés au mur, clope au bec. Ils me regardent passer, un hochement de tête en guise de salut.
— Wesh, Ales. Ça dit quoi ?
— Rien, fréro. J’vais au taf.
Ils rigolent, comme si c’était la meilleure blague du matin.
— T’as changé, gros. Tu joues plus les grands rêveurs ?
Je leur adresse même pas un regard. Je sais ce qu’ils pensent. Ales, il avait un rêve, Ales, il a son studio, Ales, il croit qu’il va percer. Ils en parlent comme si c’était mort. Peut-être qu’ils ont raison. Peut-être pas. J’ai plus le temps d’y penser.
Cité des Lilas, un nom qui sonne presque poétique quand tu le lis sur un panneau, mais ici, on sait que ça veut rien dire. C’est juste une autre barre d’immeubles, un coin gris comme tant d’autres, perdu quelque part entre Gennevilliers et Asnières.
Je marche jusqu’à la station de RER. Dix minutes à pied, toujours les mêmes. Je longe les bâtiments aux façades usées, les tags qui racontent des histoires “Ni oubli, ni pardon”, ça dit en lettres noires. Le genre de phrase qu’on écrit pour personne, parce que personne regarde.
Quelques fenêtres sont déjà ouvertes, des daronnes qui gueulent pour réveiller leurs mômes. En bas, un gars gratte un ticket de loto, appuyé contre le mur. L’espoir à deux euros.
Le terrain de foot que je traverse est désert. Il pue encore la bière renversée de la veille. Des morceaux de verre brillent dans l’herbe, et un ballon crevé traîne au fond, oublié. J’accélère un peu. Si j’arrive à la gare avant 9h05, je choppe le bon train. Après, c’est la galère.
La station de RER C est comme toutes les autres : sale, bruyante, fatiguée. Des affiches publicitaires arrachées, des mégots de clope dans les rainures des escaliers. La machine pour les tickets clignote, “HORS SERVICE”. Comme d’hab.
Je passe mon passe Navigo sur le portique et descends les marches en vitesse. 9h03. Ça va, j’suis dans les temps. Sur le quai, y’a déjà du monde. Des étudiants qui collent leurs écouteurs dans les oreilles, des types en costard qui parlent trop fort au téléphone, et des mamans avec leurs poussettes. Chacun dans sa bulle, à attendre que la journée passe.
Le train arrive dans un grincement métallique. Je monte et trouve une place dans un coin. Je cale mon dos contre la vitre, écouteur vissé dans les oreilles, musique à fond. Du rap lourd. Kool Shen, Sniper, des sons qui cognent, qui parlent de vies comme la mienne. Les basses résonnent dans ma poitrine. Ça m’aide à m’évader un peu.
Le train démarre. La voix automatique annonce les arrêts, toujours la même, toujours mécanique. “Prochain arrêt : La Défense.” Je ferme les yeux et laisse le trajet défiler. J’ai 45 minutes avant d’arriver à l’entrepôt. 45 minutes à observer, à penser, à me perdre.
Les visages des autres passagers défilent autour de moi, flous. Une nana avec un sac Louis Vuitton serré contre elle fixe l’écran de son téléphone sans lever les yeux. Un vieux, la tête penchée en avant, dort déjà. À côté de moi, un mec joue à Candy Crush en soufflant fort par le nez. Tout le monde a l’air de fuir quelque chose.
Moi, je regarde par la vitre. Les paysages défilent, les immeubles serrés les uns contre les autres, des tags qui recouvrent les murs, des terrains vagues où traînent des carcasses de voitures. C’est moche, mais bizarrement, je m’y sens chez moi. C’est tout ce que je connais.
Je repense à Adria, à son message. J’ai promis qu’on se verrait ce soir, mais je sais même pas si je tiendrai. J’ai toujours l’impression de lui mentir. Pas parce que je fais des trucs derrière son dos, mais parce que je suis un fantôme. Même quand je suis là, je suis ailleurs.
Le train ralentit en arrivant à Nanterre-Préfecture. La voix mécanique reprend :
— “Attention à la fermeture des portes.”
Je lève les yeux. Un groupe de jeunes monte dans le wagon. Ça rigole fort, ça s’interpelle. Ils sont plus jeunes, mais eux, ils ont encore cette énergie, ce feu qui brûle. Moi, il s’est presque éteint.
Quand je descends du RER, il est presque 9h50. Je traverse la zone industrielle à pied, les rues sont vides. Des hangars à perte de vue, tous gris, tous pareils. Le bruit de mes pas résonne sur le trottoir. Une bagnole passe en trombe, me projetant un nuage de poussière. Je serre les dents.
En arrivant devant l’entrepôt, Momo est déjà là, un café à la main. Il me regarde avec son air fatigué, comme si j’étais juste un autre rouage de sa journée.
— Toujours à l’heure, toi, lâche-t-il en haussant les sourcils.
— Comme toujours, Momo.
Il secoue la tête et retourne à ses papiers pendant que je file dans les vestiaires. Je pose mon sac dans un coin, enfile mon gilet jaune et attrape les clés du chariot élévateur. Une autre journée commence. Le même cycle, le même bruit, la même fatigue.
L’heure tourne et je suis au ralenti, assis dans mon chariot élévateur, casque vissé sur les oreilles, l’odeur de diesel qui pique la gorge. Cariste dans un entrepôt, c’est pas un taf qui fait rêver, mais ça paye les factures. En partie.
La machine grince quand je lève une palette trop lourde, et je me laisse distraire par le bip régulier du signal de recul. Répétitif. Écrasant. Parfois, j’ai l’impression d’être comme cette machine : bloqué dans le même mouvement, incapable de sortir de ma boucle.
— Hé, Sorbelli !
Je relève la tête. Julian, un des anciens de l’entrepôt, me fait signe depuis le sol. Il a une gueule marquée par les années de boulot et la fatigue.
— C’est pas le moment de rêvasser, frère. Les palettes, elles vont pas s’monter toutes seules.
— Ouais, t’inquiète, j’y suis.
Il ricane, une clope au coin des lèvres. J’aime bien Julian. Un vrai bosseur, comme il dit. Mais quand je le regarde, j’ai parfois l’impression de voir mon futur : trente ans dans le même trou, avec pour seule fierté d’avoir survécu jusque-là. Ça me file des frissons.
Je replonge dans mon boulot, la tête ailleurs. Chaque bip, chaque mouvement, je pense à autre chose.
La journée commence comme toutes les autres. Je suis assis dans le chariot élévateur, une main sur le levier, l’autre qui tourne nerveusement un vieux stylo entre mes doigts. Les bip-bip des machines remplissent l’air, un bruit qui devient presque un fond sonore, comme une boucle musicale sans fin.
Autour de moi, les gars de l’entrepôt gueulent pour se faire entendre. Julian, fidèle au poste, traîne une palette trop lourde pour son âge. Il me jette un regard en sueur et me crie au-dessus du vacarme :
— Ales ! Bouge ton cul, gros. Tu rêves ou quoi ?
Je fais mine de sourire, j’appuie sur le levier et le chariot redémarre en grinçant. La palette monte lentement vers les étagères métalliques. Mon dos est en feu à force de rester assis, mais je dis rien. C’est ça, le taf. Tu fermes ta gueule, tu bosses, et tu rentres chez toi avec un billet qui te suffit même pas pour vivre correctement.
Ma playlist est finie depuis une heure, mais j’ai pas pris le temps de la relancer. Pas envie de musique, pas envie de parler. La tête ailleurs, comme d’hab. Les textes que j’ai griffonnés dans mon carnet hier soir me reviennent en tête. Quelques lignes inachevées, des rimes qui parlent de sortir de tout ça.
“La journée m’écrase comme les murs du quartier,
Le rêve s’efface, mais j’continue d’gratter.
Ici, le bitume colle, comme la rancœur,
Mais tant qu’j’écris, j’mens pas sur la douleur.”
— Oh, Sorbelli, tu dors ou quoi ?!
La voix de Momo me sort de mes pensées. Il se tient devant moi, les bras croisés, son éternel gilet orange sur le dos. Le regard fatigué.
— T’es à l’ouest, frère. Faut t’remuer. T’as encore trois allées à ranger.
— Ouais. J’vais m’y mettre.
Il secoue la tête en marmonnant, mais il part sans insister. Je sais que je le saoule. Pas que lui. Tout le monde ici a l’impression que je suis ailleurs, comme si j’étais un corps sans âme, bloqué dans les mêmes gestes.
***
L’entrepôt est calme, presque vide. Je m’installe sur une palette vide à l’écart, un vieux sandwich triangle dans une main, mon téléphone dans l’autre. J’ouvre un message d’Adria que j’avais laissé en vue ce matin.
Adria: T’as mangé ?
Je tape un truc vite fait :
Ouais, tkt. T’as bien dormi toi ?
Elle répond presque aussitôt :
Adria: J’ai rêvé de toi. Ça te va comme réponse ?
Je souris malgré moi. C’est bête, mais c’est le seul truc qui me fait du bien depuis ce matin. Elle est comme ça, Adria. Elle me balance des phrases simples, sans pression. Juste assez pour me rappeler que quelqu’un m’attend.
Je range mon portable dans la poche et m’allume une clope. L’odeur me calme un peu. En face, Julian s’installe à son tour, une gamelle fumante entre les mains. Il me regarde un moment avant de lâcher :
— Tu vas finir par craquer, toi.
— Quoi ?
Il pointe sa fourchette vers moi.
— T’es pas là, frère. Ça fait des semaines. On dirait que t’as la tête à l’envers.
— C’est juste la fatigue.
Il ricane, un peu amer.
— La fatigue, c’est pas dans les yeux, Ales. C’est dans la tête.
Je dis rien. Parce qu’il a raison. Julian, il parle peu, mais quand il ouvre sa gueule, c’est souvent pour dire un truc vrai. Je tire une longue latte sur ma clope et fixe le vide. Fatigue dans la tête. Ça résume bien.
Quand je sors de l’entrepôt, le soleil est déjà bas dans le ciel. 19h04. Je traîne des pieds jusqu’à la gare, les épaules basses. Le bruit des voitures sur la quatre voies me vrille les tympans. Encore une journée à me dire que demain, ce sera différent. Mais demain, ce sera pareil.
Dans le RER, la foule est compacte. Je me cale dans un coin, écouteur dans les oreilles, comme ce matin. Les vitres sont couvertes de traces de doigts, mais j’arrive quand même à distinguer les immeubles gris de La Défense qui s’éloignent doucement.
Je reçois un nouveau message d’Adria :
Adria: T’es où ? Je passe chez toi ou pas ?
Je réponds après quelques secondes :
Passe si tu veux. J’suis bientôt là.
Elle mérite que je fasse un effort.
Le train ralentit à Asnières-Gennevilliers, et je descends avec la foule. Les lumières oranges des lampadaires commencent à s’allumer, donnant à la ville un air un peu plus sale, un peu plus vrai. Je rentre chez moi, fatigué, une seule idée en tête : tenir encore un jour.
Quand je rentre chez moi, la nuit est déjà tombée. La cité est calme, comme si tout s'était figé après le bruit du jour. La lumière orangée des lampadaires filtre à travers les stores en bois du salon. J’enlève ma veste et m’écroule sur le canapé. Le silence me tombe dessus, pesant, presque trop fort.
Quelques minutes plus tard, on frappe doucement à la porte. Une série de petits coups secs. Je sais que c’est elle.
Quand j’ouvre, Adria est là, un sourire en coin, un sac en papier dans la main. Elle porte un jean taille haute qui épouse ses courbes, un pull en laine beige qui lui tombe négligemment sur les épaules. Ses cheveux noirs, légèrement ondulés, encadrent son visage délicat. Ce soir, elle est simple, élégante, comme toujours. Ses lèvres légèrement rosées et ses yeux brillants donnent à son expression un mélange de douceur et de malice.
— T’as vu comme je t’ai ramené à manger ? dit-elle en brandissant le sac.
— Ça aurait été mieux si t’étais arrivée avec des billets.
Elle lève les yeux au ciel en entrant, mais son sourire reste.
— T’es con, Ales. Va chercher des assiettes, j’ai pas envie de manger par terre.
Je referme la porte, un sourire en coin malgré moi. Adria, c’est ça. Elle prend les devants, elle s’impose en douceur. Dans cet appart un peu pourri, elle arrive toujours à apporter un peu de lumière.
Je pose les assiettes sur la petite table basse, et Adria sort les sushis qu’elle a ramenés. Elle s’assoit en tailleur sur le tapis, me lançant un regard amusé.
— Tu vas pas rester planté comme un fantôme. Viens t’asseoir.
Je m’installe en face d’elle, mon dos contre le canapé. Je la regarde déballer les boîtes avec une précision qui me fait marrer.
— Quoi ? dit-elle en relevant la tête, ses sourcils légèrement froncés.
— T’as un truc avec les sushis, toi. On dirait que tu déballes des cadeaux de Noël.
Elle rit, ce rire clair et doux qui résonne dans la pièce. Ça me calme. Ça me fait du bien. Elle prend une paire de baguettes et tend la main vers moi pour trinquer avec un maki.
— À quoi on trinque ? je demande.
Elle réfléchit, ses yeux pétillants d’une lueur joueuse.
— À toi, parce que t’es sorti du taf vivant. Et à moi, parce que j’ai survécu à ma journée.
Je souris, touchant doucement ses baguettes avec les miennes.
— T’as raison. À nous.
On mange en silence pendant un moment. Le calme est agréable, loin du bruit de la journée. Elle me parle de son boulot, de la cliente qui a passé une heure à hésiter entre deux robes, et je l’écoute, distrait. Pas parce que ça m’ennuie, mais parce que je l’observe.
Adria a toujours eu cette façon de parler, de bouger, qui donne l’impression qu’elle danse entre deux mondes. Un monde classe, posé, et un autre plus joueur, taquin. Elle fait tourner une mèche de cheveux autour de son doigt quand elle réfléchit, et elle plisse les yeux quand elle me regarde trop longtemps.
— Arrête de me fixer, Ales.
Je relève les yeux, surpris qu’elle l’ait remarqué.
— C’est toi qui prends toute la lumière.
Elle rit encore. Je sais que ça lui plaît quand je dis des trucs comme ça, même si elle essaie de faire semblant que non.
Nous mangeons tranquillement, les voix baissées, comme si le silence du soir nous imposait une sorte de pause. Parfois, elle me parle de son boulot, de ses clientes chiantes, ou des histoires qu’elle croise dans ses journées. Moi, je l’écoute, vraiment, même si je dis pas grand-chose. Ça me plaît de l’entendre. Ça me change.
Quand on finit de manger, elle attrape une serviette pour essuyer ses mains et me regarde avec un sourire satisfait.
— Admets-le, c’était meilleur que ton kebab dégueulasse de la dernière fois.
— Ça va, j’avoue. Merci, chef.
Elle rigole encore et repose les boîtes vides dans le sac. Je me lève pour débarrasser, mais elle m’arrête.
On range tout vite fait, et elle s’installe sur le canapé, jambes repliées sous elle. Elle a enlevé son pull, ne gardant qu’un petit haut noir moulant. Simple, mais sur elle, ça claque.
— T’as bossé sur tes sons ? me demande-t-elle en désignant le carnet sur la table.
— Ouais, vite fait. J’ai pas eu la tête à ça ces derniers jours.
Elle s’empare du carnet sans me demander la permission. Elle le feuillette lentement, les sourcils froncés, concentrée.
— T’écris bien, Ales. Mais on dirait que tu parles à quelqu’un qui t’écoute jamais.
Je la regarde, surpris par ses mots. C’est souvent comme ça avec Adria. Elle dit des trucs qui te touchent en plein cœur, sans crier gare.
— C’est peut-être le cas.
 Language : English
Language : English